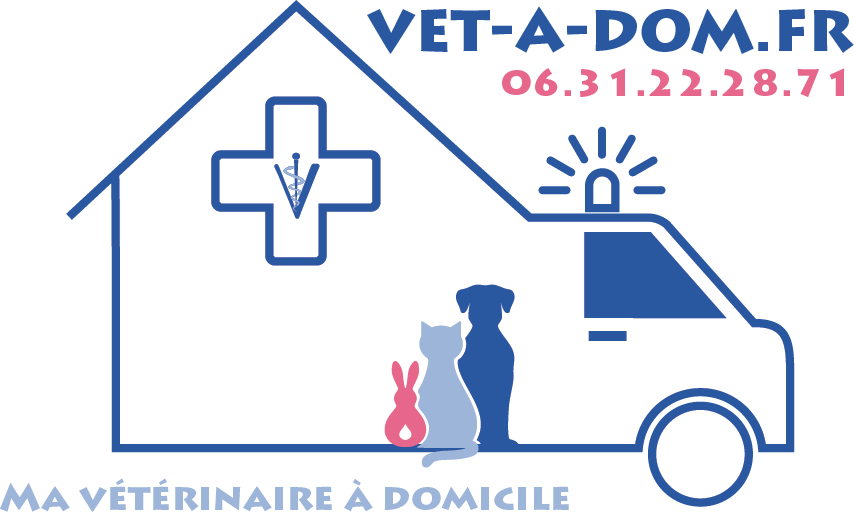Pourquoi mon chien se gratte beaucoup ?
Comprendre ce qui se passe vraiment
Voir son chien se gratter beaucoup peut vite devenir source d’inquiétude. Il se gratte la tête, les oreilles, les pattes, se lèche sans arrêt, parfois jusqu’à créer des lésions ou une perte de poils. Nombreux de propriétaires se demandent si c’est normal, si cela va passer avec le temps, ou s’il faut voir un vétérinaire.
Dans cet article, Céline Dujardin, vétérinaire à domicile à Saint-Mathieu-de-Tréviers et ses alentours, vous aide à comprendre les causes possibles des démangeaisons chez le chien, et surtout à savoir quoi faire pour améliorer le confort de votre compagnon.
Les causes possibles du grattage excessif
Un chien qui se gratte beaucoup essaie presque toujours d’exprimer un inconfort. Le grattage excessif n’est pas un comportement anodin : il a une origine bien précise, parfois physique, parfois liée à l’environnement ou à l’émotionnel.
Problèmes de peau chez les chiens
La peau du chien est une véritable barrière protectrice. Lorsqu’elle est fragilisée, des rougeurs, une inflammation, des pellicules ou des troubles cutanés peuvent apparaître. Les causes les plus courantes sont :
- une dermatite (irritation ou réaction cutanée),
- une infection bactérienne ou fongique (comme la teigne),
- une peau trop sèche ou mal entretenue,
- un changement de produits (shampoing, environnement).
- un changement de l’alimentation
Ces problèmes provoquent souvent un prurit important, parfois localisé à certaines zones du corps.
Allergies alimentaires et leur impact
Les allergies font partie des principales raisons de démangeaisons chroniques. Elles peuvent être liées à l’alimentation, notamment à certaines croquettes, protéines ou ingrédients.
Les symptômes associés sont souvent :
- un chien se gratte beaucoup sans raison apparente,
- des rougeurs sur la peau,
- des otites à répétition (oreilles sensibles),
- des pattes ou le ventre très léchés.
Dans ce cas, un ajustement alimentaire ou un test peut être nécessaire pour trouver une réponse adaptée et durable.
Parasites externes : puces, tiques et aoûtats
Les parasites externes restent une cause très fréquente de démangeaisons :
- puces,
- tiques,
- aoûtats.
- Démodex (démodécie)
- Sarcoptes scabiei (gale sarcoptique)
Même une faible présence peut provoquer une forte réaction, notamment en cas de dermatite allergique aux piqûres de puces. Le chien peut alors se gratter de manière intense, surtout au niveau du dos, de la base de la queue ou des poils.

👉 Important : on peut ne pas voir les parasites, mais leurs piqûres suffisent à déclencher un prurit sévère.
Stress, anxiété et facteurs comportementaux
Parfois, le grattage n’est pas uniquement lié à un problème médical. Le stress ou l’anxiété peuvent accentuer les démangeaisons, surtout chez les chiens et les chats sensibles. Chez le chat, ce mal-être peut aller jusqu’à un léchage excessif ou une automutilation, avec perte de poils ou lésions cutanées. Un changement de routine, l’arrivée d’un autre animal (chien ou chat), un environnement bruyant ou une séparation peuvent déclencher ce type de comportement.
Diagnostic des différentes causes de prurit chez le chien et le chat :
En cas de prurit chez le chien, plusieurs examens diagnostiques peuvent être réalisés afin d’en identifier la cause. Le vétérinaire peut commencer par des raclages cutanés pour rechercher des parasites (comme la gale ou le démodex), ainsi qu’un scotch test ou une cytologie cutanée pour détecter une infection bactérienne ou fongique. Des tests allergiques peuvent être envisagés en cas de suspicion d’allergie (alimentaire ou environnementale), parfois après un régime d’éviction.
Selon le contexte, une lampe de Wood et/ou une culture fongique peuvent être utilisées pour rechercher une dermatophytose. Des analyses sanguines peuvent être proposées lorsqu’une cause hormonale ou systémique est suspectée.
Enfin, dans les cas plus complexes ou lorsque les lésions sont atypiques, chroniques ou résistantes aux traitements, des biopsies cutanées peuvent être nécessaires afin de rechercher des maladies inflammatoires, auto-immunes ou tumorales et d’affiner le diagnostic.
Vérifier les avis et recommandations
Ne vous fiez pas uniquement aux tarifs ou à la localisation. Consultez les avis clients, discutez avec les personnes qui ont testé la garde, et surtout, rencontrez la personne qui s’occupera de votre animal. Un appel ou une visite préalable permettra d’évaluer la relation avec votre compagnon et de poser toutes les questions utiles (rythme, soins, habitudes…).
N’hésitez pas à demander :
Depuis combien d’années pratiquez-vous la garde d’animaux ?
Avez-vous déjà gardé un animal de ce type ?
Quel est votre mode de fonctionnement ?
Êtes-vous à l’aise avec l’administration de médicaments, s’il y a un traitement ?
Solutions et traitements pour un chien qui se gratte
Il n’existe pas de traitement unique pour tous les chiens. La solution dépend toujours de la cause, de la maladie éventuelle et de la situation particulière de votre animal.
Médicaments et traitements topiques

Selon le diagnostic, le vétérinaire peut proposer :
- des médicaments pour calmer l’inflammation et le prurit,
- un traitement antiparasitaire adapté,
- des soins locaux pour la peau,
- le traitement d’une infection si nécessaire.
Un traitement adapté permet souvent de soulager rapidement les démangeaisons et d’éviter l’aggravation des lésions.
Régime alimentaire et suppléments
L’alimentation joue un rôle essentiel dans la qualité de la peau et du pelage. Dans certains cas, changer de croquettes ou ajouter des compléments spécifiques peut :
- renforcer la barrière cutanée,
- réduire l’inflammation,
- améliorer le confort global du chien.
Conseils pour prévenir le grattage chez les chiens
Pour limiter les récidives et améliorer le bien-être de votre chien :
- appliquez une prévention régulière contre les puces et tiques,
- entretenez le pelage avec des soins adaptés, et éviter les shampoings trop fréquents,
- surveillez les zones sensibles (oreilles, pattes),
- évitez les produits irritants,
- soyez attentif aux signes de stress ou d’anxiété,
- privilégiez toujours une alimentation de qualité vétérinaire.
Une prévention simple et régulière est souvent très efficace.
La première étape est d’identifier la cause. Évitez l’automédication et demandez un avis vétérinaire pour mettre en place un traitement sûr et efficace.
Les démangeaisons peuvent être liées aux parasites, aux allergies, à une infection, à une une mauvaise alimentation, ou encore au stress.
Ne donnez jamais de médicaments pour humains. Seul un vétérinaire peut proposer un traitement adapté au problème de votre animal.
Quand consulter votre vétérinaire à domicile ?
Si votre chien se gratte très souvent, que les symptômes persistent, s’aggravent ou reviennent régulièrement, il est important de consulter. Céline Dujardin se déplace à domicile à Saint-Mathieu-de-Tréviers et alentours pour examiner votre compagnon dans un cadre rassurant, identifier l’origine du problème et proposer des solutions personnalisées.
👉 Un chien qui se gratte n’est pas “capricieux” : il exprime un inconfort.
Avec une prise en charge adaptée, il est possible de lui redonner rapidement bien-être et sérénité.